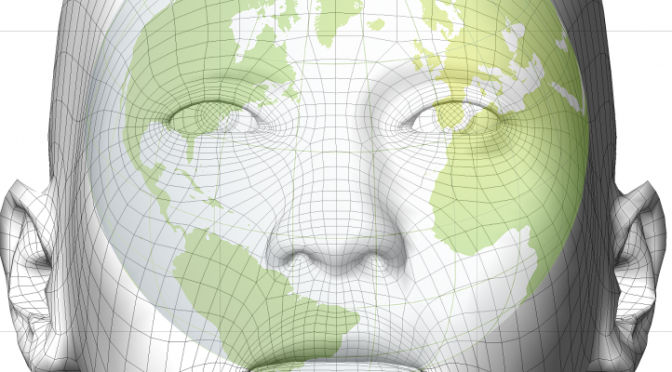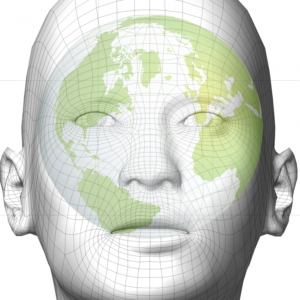
Comment des langues qui se sont épanouies dans des berceaux de civilisation distants de milliers de kilomètres peuvent-elles partager des points communs non seulement en matière de vocabulaire, mais aussi de grammaire ?
Ainsi, pourquoi les sonorités de “maman” en français, 妈妈 (“mama”) en chinois ou même أمي (“‘umi”) en arabe sont-elles si apparentées ?
Pourquoi les Français apprennent-ils à dire “papa” dès le plus jeune âge, les Russes папа (“papa”) et les Chinois 爸爸 (“baba”) ?
Les similitudes grammaticales sont encore plus incroyables.
Ainsi, dans un groupe d’Anglais, un individu pourra lancer une invitation collective à faire quelque chose par une tournure du type :
let’s watch a movie
(“regardons un film”)
où let’s est la forme contractée de let us et :
let = “laisser, laisser faire, permettre”
us = “nous”
watch = “regarder”
a movie = “un film”
Et que dirait un Chinois ?
Il dirait :
让我们看一部电影。
(“rang wo men kan yi bu dian ying”)
Or :
让 = “laisser”
我们 = “nous”
看= “regarder”
一部电影 = “un film”
Autrement dit, les Chinois comme les Anglais utilisent une tournure du type : laisser + nous + action pour traduire le fait qu’un individu lance une invitation collective à faire quelque chose à l’intérieur d’un groupe (l’impératif présent avec “nous” en français).
Comment des civilisations aussi éloignées que celles des Anglais et des Chinois ont-elles pu aboutir à la même structure ?
Faut-il voir dans ces similitudes entre langues vivantes une trace de l’universalité de certains traits de la pensée humaine ?